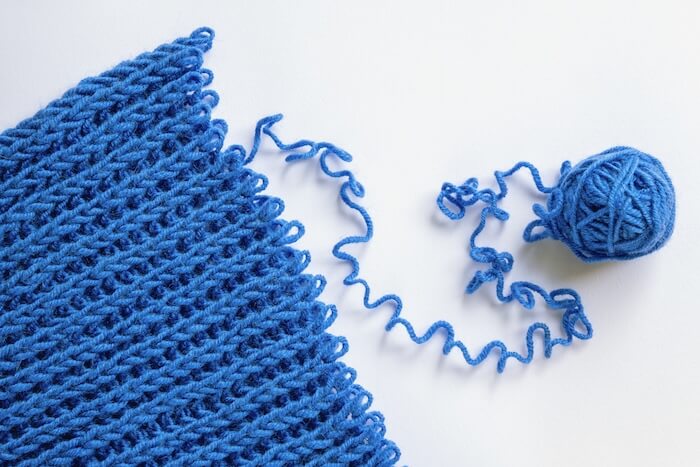EN BREF
Les politiques environnementales font aujourd’hui face à des reculs législatifs croissants, souvent justifiés par des impératifs économiques, de compétitivité ou de simplification administrative. Ces choix conduisent à un affaiblissement progressif des normes de protection de l’environnement, au détriment des écosystèmes, de la santé humaine et de la capacité des territoires à faire face aux crises climatiques.
Ces reculs se traduisent notamment par la remise en cause de principes fondamentaux du droit de l’environnement, comme l’évaluation environnementale des projets, la protection des milieux naturels et du littoral, ou encore la prévention des pollutions.
En privilégiant des bénéfices économiques à court terme, ces décisions entrent en contradiction avec les engagements climatiques et environnementaux nationaux et européens. Elles affaiblissent l’État de droit environnemental et réduisent la capacité collective à protéger les écosystèmes et à anticiper les impacts du changement climatique, alors même que ces protections constituent un socle indispensable pour une économie durable et résiliente.
L’Union Européenne traverse actuellement une période particulièrement préoccupante pour la protection environnementale.
Sous prétexte de vouloir dynamiser l’économie et renforcer la compétitivité des entreprises européennes, les institutions européennes multiplient les reculs concernant les lois environnementales, cédant aux lobbies industriels et à leur vision court-termiste.
La situation est d’autant plus frustrante que nombre de ces règlementations et directives européennes ont nécessité un travail et une mobilisation colossale de la part de la société civile et des citoyens européens, pouvant être réduits à néant en quelques jours ou semaines.
Face à cette érosion organisée du droit environnemental européen, il nous a paru essentiel de dresser un bilan des reculs, dérogations et ajustements déjà apportés aux textes législatifs pour lesquels nous nous sommes mobilisés et que vous avez pu soutenir.
Restriction sur les microplastiques dans les cosmétiques : des exceptions qui vident le texte de sa substance
Un bref rappel
En avril 2023, l‘Union européenne avait finalement adopté l’interdiction des microplastiques intentionnellement ajoutés dans les produits cosmétiques, après de longs mois de reports. Cette mesure prévoyait un délai de 6 ans pour les produits à rincer et de 12 ans pour le maquillage – des échéances que nous jugions déjà trop longues.
L’enjeu est pourtant considérable : actuellement, 40 000 tonnes de microplastiques cosmétiques se retrouvent chaque année dans l’environnement européen, ces particules étant présentes dans 90% des produits du quotidien. Plusieurs marques engagées prouvent pourtant qu’il est possible de proposer des alternatives naturelles efficaces.
Lire aussi : L’interdiction des microplastiques dans les cosmétiques encore repoussée
L’affaiblissement de la restriction concernant les microplastiques intentionnellement ajoutés dans les produits cosmétiques illustre parfaitement cette tendance préoccupante. Le dispositif réglementaire, dans sa version actuelle, présente des lacunes béantes : seuls les produits contenant des paillettes vendues séparément sont effectivement interdits, tandis que ces mêmes paillettes demeurent autorisées dans les autobronzants, les produits de maquillage ou les gels douche, sous prétexte qu’aucun effort majeur n’a été entrepris par l’industrie pour reformuler les produits contenant des paillettes.
Face à cette restriction, une entreprise de décorations de Noël a contesté l’interdiction en justice, poussant la Commission à exempter la plupart des utilisations de paillettes de l’interdiction. Une capitulation face aux pressions industrielles.
Plus préoccupant encore, la Commission élabore actuellement des lignes directrices visant à réduire potentiellement la portée de la restriction.
Ce processus se déroule à huis clos, sans aucune consultation des ONG, remettant en question la transparence démocratique de ces décisions.
Réglementation sur les emballages et déchets d'emballages : capitulation face au lobbying de la restauration rapide
Un bref rappel
L’ambition initiale de la Commission européenne était de réduire la quantité d’emballages mis sur le marché dans l’Union européenne en améliorant leur conception pour permettre le réemploi, en luttant contre le suremballage et en réduisant les emballages à la source.
Les données d’Eurostat montrent que les déchets d’emballages en Europe continuent d’augmenter, avec plus de 188 kg de déchets par an et par habitant en 2021, soit 10,8 kg de plus qu’en 2020.
Le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages illustre de manière exemplaire l’efficacité des stratégies d’influence industrielle.
Après quinze mois de négociations intenses, ce texte a subi un affaiblissement progressif et systématique, particulièrement concernant l’encadrement des emballages en papier ou carton dans le secteur de la restauration.
L’influence exercée par les chaînes de restauration rapide, les industriels du plastique et la filière papier-carton a profondément affaibli l’ambition initiale du règlement. Ces acteurs économiques ont déployé des stratégies de lobbying particulièrement sophistiquées à Bruxelles, incluant la production d’études orientées destinées à contredire les analyses d’impact de la Commission européenne.
Cette influence s’avère d’autant plus problématique qu’elle contrevient aux données scientifiques établies sur la supériorité environnementale du réemploi par rapport aux solutions à usage unique.
Malgré ces évidences scientifiques, les institutions européennes ont accédé aux demandes des multinationales de la restauration rapide et de l’industrie papetière, préservant l’utilisation d’emballages à usage unique dans la restauration. Cette concession majeure vide le règlement d’une part significative de son efficacité environnementale.
Règlementation concernant les Granulés plastiques industriels : des dérogations qui compromettent l'efficacité du dispositif
Un bref rappel
Après de longs mois de travail en collaboration avec d’autres ONG, le sujet des granulés plastiques industriels a enfin été pris en considération à Bruxelles.
Le nouveau règlement comprend des exigences minimales contraignantes pour tous les transporteurs et opérateurs, avec un champ d’application élargi à la navigation maritime, suivant une approche intégrale de la chaîne d’approvisionnement couvrant chaque étape – production, transformation, transport, stockage, nettoyage et retraitement.
La réglementation européenne relative aux granulés plastiques industriels constitue un énième exemple de cet affaiblissement réglementaire organisé, caractérisé par l’introduction de dérogations en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette décision exclut les petites et moyennes entreprises de la plupart des obligations réellement contraignantes, malgré leur proportion très importante dans la chaîne de valeur du plastique.
L’accord final exempte la majorité des PME de toute surveillance indépendante, alors même qu’elles représentent l’essentiel de la chaîne d’approvisionnement en plastique : 98% des acteurs dans la transformation et 97% dans le transport et le stockage. Au lieu d’adopter une approche fondée sur les risques ou les volumes, la réglementation exclut les opérateurs gérant moins de 1 500 tonnes par an et par installation – un seuil élevé équivalant à 75 milliards de granulés manipulés annuellement par un seul site.
Plus préoccupant encore, même les petites entreprises dépassant ce seuil bénéficieront d’obligations allégées, notamment une certification unique à effectuer cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement. Cette approche exclut un grand nombre d’acteurs industriels importants du champ de contrôle régulier, ouvrant la voie à une conformité lacunaire et non vérifiée. Sans surveillance continue, cet allègement compromet l’objectif même du règlement : une prévention complète à l’échelle de toute la chaîne d’approvisionnement.
Directive sur les eaux résiduaires urbaines : quand le principe pollueur-payeur devient optionnel
Un bref rappel
La révision de la Directive européenne des Eaux Résiduaires Urbaines, datant de 1991, a été adoptée après plus de deux ans de négociations.
Ce texte a introduit des mesures importantes comme le traitement quaternaire pour éliminer les micropolluants dans les grandes stations d’épuration (plus de 150 000 habitants) et reconnu pour la première fois la pollution par les biomédias.
L’enjeu est colossal : 108,85 millions de m³ d’eaux usées sont produits quotidiennement dans l’UE.
Lire aussi : Directive sur les Eaux Usées : une mise à jour cruciale pour protéger l’Océan et notre santé
La révision de la Directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU) constitue un autre exemple significatif de ce recul réglementaire, particulièrement concernant l’application du principe pollueur-payeur aux industries pharmaceutiques et cosmétiques.
Le mécanisme de responsabilité élargie des producteurs (REP), introduit initialement en avril 2024 pour imputer aux industriels les coûts du traitement avancé des micropolluants, a subi un affaiblissement notable lors des négociations : la version finale ne prévoyant plus qu’une prise en charge de 80% des coûts par les industriels, les 20% restants étant transférés aux autorités publiques.
Face à cette mesure, les entreprises du secteur pharmaceutique ont exercé une pression particulièrement forte, invoquant le coût considérable induit par le principe de Responsabilité Élargie des Producteurs, qu’elles seraient alors « obligées » de reporter sur les médicaments. Le secteur cosmétique a, quant à lui, contesté sa part de responsabilité dans la pollution et dénoncé une répartition inéquitable des contributions financières.
Ces deux industries ont désormais engagé des recours juridiques visant à obtenir une révision plus favorable encore de cette REP, laissant présager un abandon probable du principe pollueur-payeur dans ce domaine.
Directive des Eaux de Baignade : un abandon discret mais révélateur
Directive Green Claims : l'abandon d'un outil essentiel de lutte contre le greenwhasing
Le retrait annoncé de la directive « Green Claims » constitue un dernier exemple de cette régression réglementaire. Sous la pression conjuguée de formations politiques conservatrices et de lobbies industriels, la Commission européenne s’oriente vers l’abandon pur et simple de cette proposition législative anti-greenwashing.
Cette directive représentait pourtant un outil réglementaire essentiel pour encadrer les allégations environnementales des entreprises. Le dispositif prévoyait notamment l’obligation de certification préalable par un organisme tiers indépendant de toute allégation environnementale avant commercialisation. Cette mesure aurait interdit aux entreprises l’usage d’allégations telles qu' »écologique », « neutre en carbone » ou « préservant la biodiversité » sans validation scientifique rigoureuse de ces affirmations.
L’abandon de ce texte intervient alors qu’il avait atteint le stade du trilogue, phase avancée du processus législatif européen, témoignant de sa maturité juridique et technique. Cette directive visait à encadrer de manière systématique les communications d’entreprises intégrant des allégations environnementales, enjeu crucial dans un contexte de généralisation des pratiques d’écoblanchiment.
L'omnibus environnemental : vers un grand démantèlement des acquis
L’omnibus environnemental, attendu pour la fin de l’année, constitue sans doute l’expression la plus aboutie de cette logique de régression réglementaire. Cette proposition législative, qui fait suite à la consultation controversée sur les prétendus obstacles que représenteraient les réglementations environnementales pour la compétitivité des entreprises européennes, s’annonce comme un grand démantèlement des acquis environnementaux et sociaux.
Sous couvert de « simplification administrative » pour les entreprises, cette directive propose l’affaiblissement, voire la suppression, de nombreuses obligations en matière de durabilité et de protection des droits humains. Cette démarche s’inscrit dans une logique de déréglementation massive qui fait abstraction des enjeux climatiques et environnementaux de long terme.
Ce tour d’horizon révèle une tendance profondément inquiétante : l’Union Européenne semble avoir choisi de sacrifier ses ambitions environnementales sur l’autel de la compétitivité économique à court terme. Face à ces reculs organisés, il est plus que jamais nécessaire de maintenir la pression citoyenne et de rappeler aux décideurs européens que la protection de l’environnement et de l’océan ne peut pas être négociable. L’avenir de nos écosystèmes et de notre santé en dépend.
Tout comprendre sur les reculs legislatifs en 6 questions !
Qu'est ce qu'un recul législatif en matière d’environnement ?
Un recul législatif désigne l’affaiblissement, la suppression ou le contournement de lois existantes qui protègent l’environnement, souvent au nom de la compétitivité économique ou de la simplification administrative.
Pourquoi observe-t-on des reculs des lois environnementales aujourd’hui ?
Ces reculs sont souvent justifiés par des arguments économiques à court terme : baisse des coûts pour les entreprises, accélération des projets industriels ou réponse à des crises économiques, énergétiques ou agricoles.
Quelles lois environnementales sont concernées par ces reculs ?
Les reculs législatifs touchent notamment la protection des milieux naturels, la lutte contre les pollutions, l’évaluation environnementale des projets, la protection du littoral et les normes encadrant les activités industrielles.
Quels sont les impacts concrets de ces reculs sur l’environnement ?
Ces reculs sont-ils compatibles avec les objectifs climatiques et environnementaux ?
Non. En affaiblissant les règles de protection, ces choix compromettent l’atteinte des objectifs climatiques, la préservation de la biodiversité et l’adaptation des territoires aux impacts du changement climatique.
Peut-on concilier économie et protection de l’environnement ?
Oui ! Des politiques publiques ambitieuses peuvent soutenir une économie durable, créatrice d’emplois et respectueuse des limites planétaires, sans sacrifier la protection de l’environnement au profit de gains économiques à court terme.